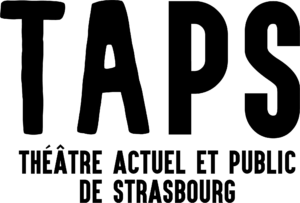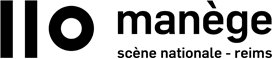Szenik a rencontré la metteuse en scène Magrit Coulon (Compagnie wozu ?) et les comédien.ne.s Carole Adolff, Anaïs Aouat et Tom Geels dans la cour du Théâtre des Doms pour apprendre un peu plus sur leur démarche de création de cette pièce émouvante et pertinente.
Trois résident·e·s attendent.
Une table, trois chaises, une horloge, un fauteuil, une radio.
C’est une salle commune. Un espace pour être ensemble, un espace où l’on est seul.
Il ne se passe rien.
On attend le·la médecin, un appel, ou une visite.
Comment faire entrer 90 ans d’existence dans une chambre de 15m2 ? Et que voit-on du monde depuis ces lieux-là ? Maison de retraite, hospice, Ehpad en France, home en Belgique : la diversité d’expressions pour nommer les lieux où l’on « place » nos aîné·e·s cache mal leur décor désespérément uniforme et aseptisé.
Dans HOME de Magrit Coulon, trois jeunes comédien·ne·s prêtent leurs corps aux voix des anciens. D’un tableau à l’autre, véridique ou vraisemblable, la rythmique d’un quotidien en huis-clos, la mécanique des mouvements et des latences, des souvenirs et des espérances, transforment la maison de retraite en un espace de vies et de fantasmes.
Pour votre premier spectacle vous avez choisi un sujet qui n’est pas très habituel pour une jeune compagnie. Tandis que la plupart se hâte de parler de politique ou de révolution, vous avez choisi le sujet de la vieillesse. Pourquoi ?
Magrit : Parce qu’on pense que les vieux devraient faire partie de la révolution. Pour nous, les personnes âgées sont nos grands-parents. Ce sont des personnes à part entière. La vieillesse n’est pas juste « une perte de » ou un délabrement, bien au contraire. Ce sont des personnes auprès desquelles nous nous sentons bien et qui apportent beaucoup. Ensemble, nous nous posions la question de la place de la vieillesse dans notre société : Pourquoi ne croise-t-on presque plus de personnes âgées dans la rue? Pourquoi si peu de vieillesse dans notre expérience de vie, alors qu’on est jeune et qu’on a besoin d’eux ?
Vous interprétez parfaitement les corps des personnes âgées. Chaque geste et chaque expression peut nous rappeler un mouvement que nous avons tous déjà remarqué auprès d’une personne âgée. Quelle a été votre méthode pour vous emparer de ces corps ?
Carole : Magrit nous a emmené dans son processus. Elle est allée dans une maison de retraite à la rencontre des personnes âgées à Ixelles (Bruxelles). Nous avons passé beaucoup de temps à créer un lien avec eux. C’était important pour nous de les rencontrer au lieu d’être seulement un.e simple observateur / -trice. Que ce soit une rencontre d’humain à humain.
Anaïs : L’idée était aussi de s’imprégner de l’atmosphère du lieu, du rythme, de l’odeur, des distances entre les meubles, des relations entre ces gens qui ne se sont pas choisis, des regards entre eux… Ce microcosme de vie dans un espace où beaucoup y terminent leur vie.
Nous nous sommes concentrés sur l’espace commun qui faisait office de réfectoire, et puis sur le personnel qui y travaillait. Même si nous ne les représentons pas, il y a tout ce monde autour qui gravite et qui participe à ce qu’ils sont.

Qu’avez-vous ressenti lors de ces rencontres en maison de retraite ?
Magrit : J’y allais parce que j’étais heureuse d’aller à la rencontre de ces gens, leurs histoires, leurs rapports à la vie, leur humour et même le détachement que certains d’entre eux peuvent avoir. Après, tout n’est pas joyeux. Parfois on sortait de la maison de retraite et on se sentait triste à cause des moments douloureux auxquels nous assistions. Mais ce n’était jamais une peine. Il y a vraiment quelque chose de l’ordre de la vie, c’est triste et joyeux en même temps.
Question pour Tom, Carole et Anaïs : Vous jouez des personnes qui ont perdu le contrôle de leurs corps. Et pourtant, en tant que comédien.ne.s , le contrôle de votre corps est essentiel. Comment vous êtes-vous préparés à « cette perte » ?
Tom : En plus de toutes ces observations qu’on a fait en maison de retraite, on a complété ces expériences avec un travail physique. Nous avons par exemple utilisé la méthode Feldenkreis. Natacha Nicora est venue en tant que coach et nous a beaucoup aidé avec la création d’une technique autour de ces corps. Il faut rendre technique tous ces gestes et ces mouvements, parce qu’ils sont des outils concrets pour nous. On a essayé de trouver de différentes portes d’entrée, comme par exemple le butō.
C’est vertigineux de transformer son rapport aux choses, de voir le sol parfois comme un ennemi ou d’être un peu accaparé par les grands espaces, de pouvoir tomber ou de transformer un geste minuscule en une action qui dure longtemps.
Avec toutes ces observations, tu te rends compte que chaque geste, chaque mouvement qui nous parait si normal, comme prendre son téléphone ou prendre le métro, perdait toute notion du temps. Rien que boire une gorgée de jus de pomme prenait le temps que ça prenait.

À plusieurs moments dans le spectacle, vos corps disent bien plus que les mots. Le silence y joue également un très grand rôle.
Magrit : Une salle commune dans une maison de retraite est bien plus bruyante que dans notre spectacle, mais ce sont surtout les corps qui sont très bruyants. Et c’est ce que nous avons voulu montrer avec le début du spectacle. Le temps partagé dans les espaces communs et les moments d’attente sont très silencieux, parce que ces personnes ne communiquent pas uniquement avec le langage.
Et puis nous nous sommes questionnés sur comment la parole pouvait faire émerger le silence et vice-versa. L’économie de parole leur donne une plus grande résonnance, leur permet de résonner autrement.
Le temps semblait s’arrêter dans la salle. Avez-vous fait ce choix pour « déséquilibrer » les spectateurs ?
Magrit : On travaille clairement sur le contraste avec l’extérieur, qui est aussi lié à la sensation que nous avons eu durant nos visites en maison de retraite. Là où nous avons travaillé, il y avait des doubles portes et des codes à l’entrée, donc à chaque fois on avait l’impression de laisser quelque chose de la vie quotidienne derrière nous pour entrer dans une sorte de Tupperware – un espace clos, quasi hermétique, où même les bruits arrivent de loin.
L’idée c’était donc de provoquer chez le spectateur cette sensation de coupure, qu’il ait l’impression d’entrer dans un lieu avec d’autres lois, un lieu où le temps peut passer différemment.
Anaïs : En tant que visiteurs, nous avons reçu beaucoup de générosité de leur part, parce que nous étions un moyen pour eux de s’exprimer, de donner une réserve de vie qu’ils gardait.

Votre spectacle présente des situations comiques et en même temps il y a une note de tristesse qui résonne. Comment garder l’équilibre entre le comique et le sérieux ? Et, comment ne pas tomber dans la caricature ?
Magrit : C’est bien pour cela que ces visites ont été si précieuses. Nous nous y sommes rendus bien avant même les premières répétitions, afin de nous forger une expérience intime de ce lieu et des gens qui y habitent, une expérience de réel qui serait indiscutable, pour surtout ne pas travailler à partir des clichés que l’on avait forcément au départ. Cette expérience-là, qui a vraiment été fondatrice, est devenue une sorte de boussole pour conserver l’équilibre entre ce que nous avons vu et ce qui est imaginé.
Ce qui nous permet aussi d’éviter la caricature, c’est l’endroit de compréhension que l’on essaye d’avoir. Par exemple, au lieu de représenter quelqu’un qui marche lentement, parce qu’on se dit que les personnes âgées marchent lentement, on se rappelle que la personne en question aimerait marcher vite, mais que quelque chose l’en empêche, son bassin qui bloque par exemple. On repart de choses physiquement très concrètes, qui nous permettent de ne pas poser toujours la question du théâtre (à quel rythme je marche), mais de la faisabilité (avec cette structure physique, je ne peux pas marcher plus vite).
Anaïs : Il n’y a pas eu de volonté de créer des personnages. Quand nous avons rencontré ces personnes, nous n’avons pas choisi des caractères pour les copier. C’est une combinaison d’impressions et de silhouettes qui ont des degrés différents de sénilité, de vie. Nous avons toujours essayé de ne pas se réduire à un caractère, un corps. Donc il y a des portes qui restent toujours ouvertes, parce qu’on est aussi au théâtre. Nous nous sommes rapidement posés la question de la place de notre travail documentaire sur un plateau de théâtre, car nous ne sommes pas « des corps vieux ».
Le rapport entre la scène et la salle est particulier dans ce spectacle. Nous avons eu l’impression d’être à la fois complice et visiteur.
Carole : On invite le public à notre processus et aux réalités que nous avons vécu dans les maisons de retraite. Les spectateurs sont au départ considérés comme des visiteurs. Nous même, nous sommes en attente et les observons. On inverse d’abord le rapport scène – salle pour ensuite inviter les publics dans notre espace.
Tom : Ce début de spectacle est un réel plaisir. C’est le moment où on peut jouer avec toute la malice que nous avons vu dans les maisons de retraite, où on tire sur le temps et où nous plongeons dans le concret du présent. Ça rassemble complètement le public et nous. J’ai l’impression que ça met le public au diapason de nous, de notre temps, de notre rythme. C’est vraiment le moment où tout se met ensemble pour qu’on puisse ensuite rentrer dans le temps du théâtre. Ce premier passage est nécessaire.
Magrit : C’est vrai que c’est comme la première couche pour que tout puisse après advenir. C’était très important pour nous de travailler sur la question de l’attente, parce que ce sont des choses que nous avons vécu dans les maisons de retraite. C’est-à-dire : quelqu’un arrive à 10h00 dans le réfectoire, et s’installe à sa table pour attendre le repas de midi.
Évidemment il y a des similitudes avec l’attente des spectateurs qui entrent dans la salle et attendent quelque chose de la pièce qu’ils viennent voir. On leurs renvoie cette sensation en disant « Nous aussi, nous attendons. ». Quand par exemple quelqu’un tousse dans la salle, ça devient un évènement pour tout le monde.

Tom, Magrit, Carole : Que ressentez-vous quand vous êtes sur scène et présentez votre spectacle ? Craignez-vous le carnet dans lequel Magrit prend des notes durant la représentation ?
Carole : Moi, j’ai peur du carnet de note de Magrit (rit).
C’est un vrai plaisir de partager cette histoire avec les spectateurs, de la raconter ensemble et de témoigner de ce que nous avons traversé. Surtout après cette année terrible, nous n’avons pas pu retourner dans les maisons de retraite, ce qui nous manque profondément. On pense à eux et on sent que c’est tellement important de partager.
Je sens que nous sommes très fort ensemble grâce à cette aventure que nous avons vécu. Nous continuons toujours à rester dans l’exigence et dans le travail des détails d’où le carnet de Magrit qui est très important pour nous. En général, on se retrouve après le spectacle autour d’un café crème pour parler de ses notes et pour réfléchir à comment nous pourrions être encore plus juste.
Avec cette pièce, vous êtes témoins de vies et de personnes que nous n’entendons malheureusement que trop peu. Donner de la voix à quelqu’un et partager sa vision du monde, était-ce un facteur qui vous a influencé lors de votre décision de faire du théâtre ?
Anaïs : J’ai l’impression d’être une intermédiaire entre ce que j’ai pu voir et ceux qui sont venus pour le réceptionner. C’est comme ça que je considère pour l’instant ma présence et mon désir d’être sur scène.
Tom : Avec le réel, il y a quelque chose qui est plus fort que tout. Quand tu fais référence à des personnes ou à des lieux que tu connais, tout s’aligne. Cette démarche du théâtre documentaire est essentielle pour moi. Le théâtre est aussi un médium qui permet de magnifier, de transformer les choses. On joue beaucoup avec ça et c’est ce que j’aime beaucoup dans ce métier.
Carole : J’aime beaucoup cet aspect-là dans le théâtre documentaire : questionner le réel et le mettre sur un plateau. Donner un certain regard, mais poser des questions ensemble. Extraire quelque chose du réel et le transformer, c’est un point de départ qui m’attire et qui m’émeut.
Magrit : Je fais du théâtre, parce que je crois que je ne sais rien faire d’autre. Et le théâtre que j’imagine n’est pas tant celui du texte que celui du présent, du réel, le récit de quelque chose qui fait partie du monde et que l’on peut re-raconter.
Les 18 mois dont on sort étaient vraiment difficiles, d’autant plus parce que nous sommes très jeunes. Puis, choisir de faire du théâtre peut sembler bizarre aujourd’hui. Et là encore plus, car on se rend compte que le théâtre peut disparaitre et que ça manque pas tant que ça (enfin, c’est comme ça que je l’ai ressenti). Je crois que ça nous montre à nouveau pourquoi c’est si précieux.
… Aussi précieux que les personnes âgées qui ont toute leur place dans nos sociétés.

Prochaines dates
03.09.2021 Théâtre de Namur, Namur (Belgique)
12.10.2021 › 16.10.2021 Théâtre Océan Nord, Bruxelles (Belgique)
20.10.2021 Le Manège, Maubeuge (France)
12.11.2021 › 13.11.2021 Théâtre Sorano, Toulouse (France)
12.01.2022 › 22.01.2022 Théâtre National de Fédération Wallonie-Bruxelles, Bruxelles (Belgique)
26.01.2022 › 27.01.2022 Maison de la culture/Centre scénique, Tournai (Belgique)
22.04.2022 Maison de la Culture, Ath (Belgique)
31.05.2022 Centre Culturel, Uccle (Belgique)
En savoir plus sur Magrit Coulon
Magrit Coulon, metteuse en scène d’origine franco-allemande, est née à Strasbourg. Formée à la mise en scène à l’INSAS à Bruxelles, elle s’éloigne progressivement du théâtre de texte pour s’intéresser à l’écriture de plateau innervée par une recherche documentaire. Au cœur de son processus : l’architecture et le temps. Comment un espace se raconte ? Comment le temps se déplie ?
En parallèle à l’écriture de son prochain spectacle, elle co-fonde avec Bogdan Kikena la compagnie wozu? et poursuit un master international en Comparative Dramaturgy and Performance Research, entre Bruxelles et Francfort.
L’Avenir, sa deuxième pièce, commence là où Home finit, à la lisière d’une forêt de sapins.
HOME a obtenu le Prix Maeterlinck de la Découverte 2020
***
Interview, photo couverture : j. lippmann
Le 21 juillet 2021 au Théâtre des DOMS
Festival OFF d’Avignon 2021